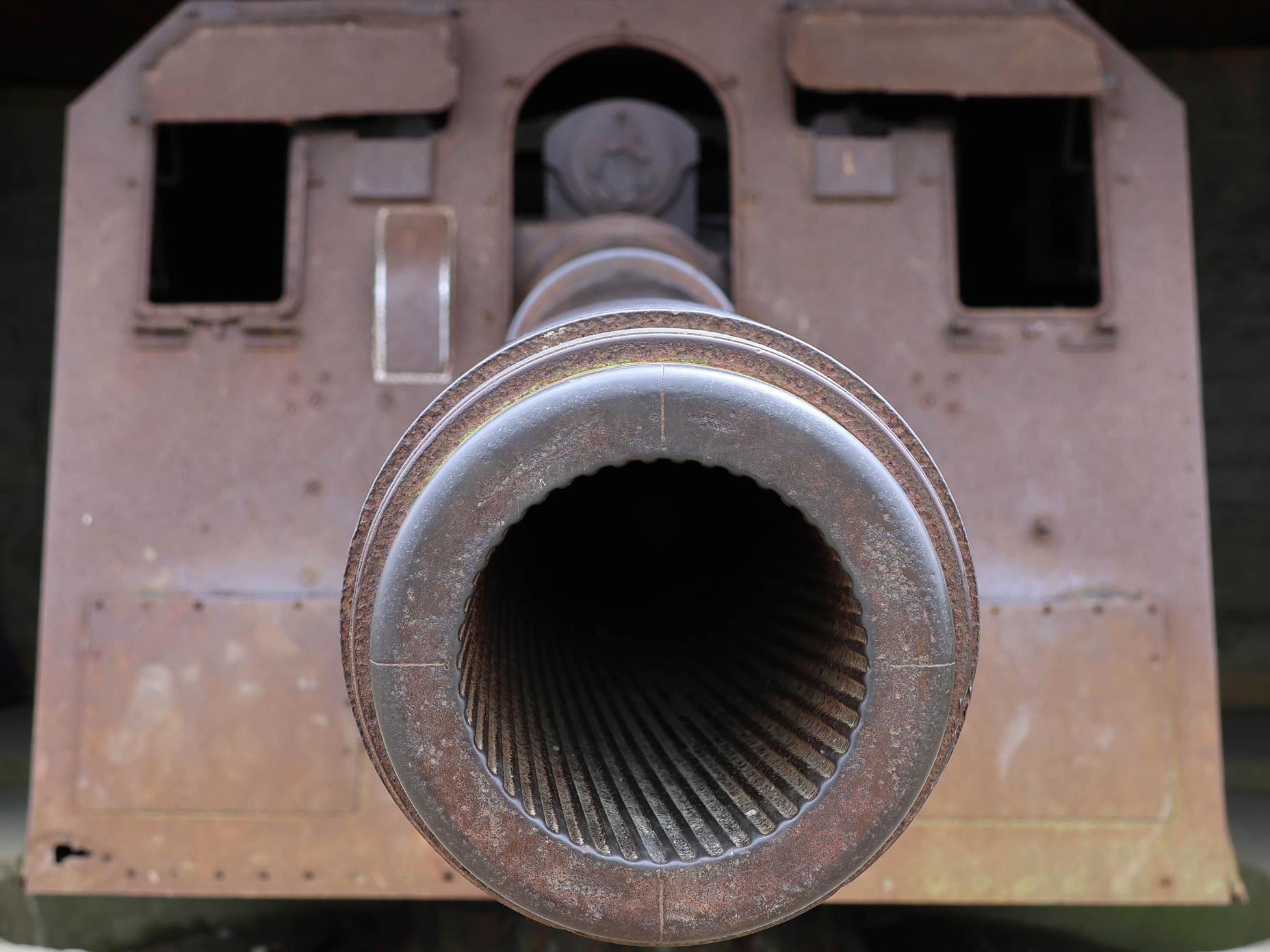Raconter Toulouse n’est pas chose aisée tant la cité occitane fut le théâtre d’histoires diverses et variées des Comtes de Toulouse à notre époque. Il nous est parvenu des bâtiments de nombreuses époques toujours en activité en tant que musée, habitation ou encore en banque comme c’est le cas d’une partie de l’Hôtel Dahus et ses fenêtres gothiques du XVème siècle.

XIIème siècle : la Tour Maurand

Notre aventure dans le passé débute au XIIème siècle avec la Tour Maurand. Dans le petit bourg au tour de la Basilique Saint Sernin, à la croisée des rues du Taur et du Périgord, demeure un vestige de l’ostel Maurand. La famille Maurand fut proche par les proches conseillers des Comtes de Toulouse. Peyre Maurand sera un changeur (homme qui échange des monnaies d’un pays contre des monnaies d’un autre), il sera riche. Malheureusement pour lui, il aura épousé la religion cathare. Il sera présenté au légat du Pape, en 1178, battus et devra abjurer sa foi cathare. Ayant obtempéré, Payre ne sera pas exécuté mais verra ses biens confisqués. Il devra également détruire ses tours, symboles de puissance, à partir à Jérusalem dans les 40 jours pour servir les pauvres. La tour est un vestige de cet hôtel qui fut remanié. Elle aurait perdue 10 mètres de sa hauteur originelle mais reste tout de même un témoignage de l’architecture romane du XIIème siècle.
XIIIème siècle : la Trésorerie Royale

En 1278, Toulouse est rattaché au Royaume de France. Dans le même temps, à la fin du XIIIème siècle, le pouvoir royal établit son autorité sur la cité. Des bâtiments vont donc être bâtis comme celui du Trésor : la Trésorerie royale. Dans une tour carrée de 20 mètres de haut et de deux ailes relativement petite et plus basses, siège le représentant des finances du Royaume. Le Trésorier a pour rôle de récolter l’argent dû au Roi au titre des impôts mais plus encore il pourra se faire juge des questions relevant de l’impôt. Il également évident que l’aspect de la tour, du donjon, implique que le lieu a pu servir de coffre pour entreposer la récolte de l’impôt. Au cours du XVème siècle, la Trésorerie évolue dans son architecture vers son aspect actuel, avec en plus ses créneaux pour la défense militaire. Après la révolution, le bâtiment est dévolu à des religieuses jusqu’en 1904. L’Église Réformée acquiert la tour en 1908, de nouvelles fenêtres y sont percée pour y mettre des vitraux : le lieu devient le Temple du Salin.
Du XIVème au XVIIIème siècle : les maisons "à corondage de massécanat"
Toulouse possède aussi un patrimoine moins visible mais tout aussi essentiel de l’histoire de la cité. Les habitants de la cité n’ont pas tous les moyens de se faire bâtir un ostel avec une belle tour s’escalier alors certains vont faire bâtir des maisons à pans de bois (il en resterait 200 à Toulouse). La maison est nommée à corondage de massécanat. Cette technique se base sur deux marchandises : le bois (des poutres de chênes ou de pin) et des briques (souvent de types forain, d’une dimension importante appliquant la règle des 2/3 dans le rapport largeur et longueur). Citons à cet égard la maison du Capitoul Pierre de Serta.

XVème siècle : l’Hôtel Dahus

L’Hôtel Dahus aura reçu nombre de personne d’importance. En effet, il est bâti dans les années 1460 pour un homme d’importance : Pierre Dahus. Docteur en droit puis juge, il possède un terrain si vaste qu’il y fait bâtir son hôtel particuliers. Il est élu capitoul en 1474. À son décès en 1483, l’hôtel est transmis à son épouse, elle en loue une partie au capitoul Pierre de Roquette. L’hôtel Dahus est finalement vendu, en 1504, à Vincent de Roquette. En 1518, celui-ci va le louer à Pierre de Nupces, le Président du Parlement de Toulouse depuis 1504. L’hôtel accueillera également Guillaume de Tournoer, qui sera également Président du Parlement de Toulouse qui y fait construire la tour à partir de 1532. Entre les mur du bâtiment du XIVème siècle va donc évoluer nombre de personnes d’importance de la ville. Résistant à nombre de siècles, il sera en parti démantelé, pour le percement d’une rue. Une partie du logis ancestral y sera conservé et l’on y accole la tour Tournoer, qui sera démontée puis remontée à son emplacement actuel.
XVIème siècle : la Renaissance les hôtels de Felzins et d’Assézat
La Renaissance qui prône le retour à l’antique finit par arrivée à Toulouse. La ville riche et puissante de par son pastel. La basilique Saint Sernin conserve son manteau roman bien qu’on lui ajoute un portail renaissance. Le dynamisme de l’époque va surtout se remarques dans de nombreux hôtels particuliers qui nous sont parvenus. Entre 1537 et 1570, Gaspard Molinier qui est conseiller au Parlement de Toulouse va acquérir deux maisons et faire bâtir son hôtel autour d’une cour centrale : l’hôtel de Felzins. La brique, la pierre, les marbres font un jeu de couleurs qui fait montre d’une richesse importante. Le style maniériste des personnages présents sur le fronton du portail de la rue de la Dalbade est un sublime témoignage du talent de l’époque.

Parallèlement, l’architecte toulousain Nicolas Bachelier offre les plans de l’hôtel d’Assézat. Pierre d’Assézat est un riche marchand toulousain du pastel, de la Renaissance. Il sera deux fois capitoul. Entre 1555 et 1562, l’hôtel est édifié. Le bâtiment est un vaisseau de brique avec un décor de pierre qui fait un bien bel effet. Le bâtiment de trois étages, d’inspiration antique, qui s’articulant autour d’une belle cour est renforcée par une puissante tour d’escalier en brique.ici

XVIIème siècle : façade de l’hôtel de pierre
Jean de Bagis acquiert un ensemble de cinq immeubles qu’il transforme en un hôtel, à partir de 1537. Un apothicaire fortuné, qui sera plusieurs fois capitoul, acquiert l’hôtel en 1601. Sa fille, Gabrielle de Guerrier en hérite en 1606. Elle épouse François de Clary qui sera conseiller du Roi et Président du Parlement de Toulouse. Ensemble, ils décident d’agrémenter leur hôtel d’une nouvelle façade. L’architecte Pierre Souffron prend en charge le chantier : l’hôtel de pierre se retrouve enrobé d’une façade de pierre. En son centre une double porte fait naître une certaine symétrie parmi les huit travées qui composent la façade. L’ensemble est un rayonnement de sculpture : pilastres, chapiteaux, trophées, guirlandes, fruits, héros de l’antiquité, …

XVIIIème siècle : Hôtel du Barry

En face de la basilique Saint Sernin, l’on trouve le lycée du même nom, il siège dans l’hôtel Du Barry. En 1776, Jean-Baptiste du Barry acquiert des terrains et un ancien hôtel particulier pour y bâtir sa demeure loin de la Cour où il n’est plus le bienvenu. Du Barry, un nom qui raisonne dans l’Histoire de France. Jean-Baptiste est le proxénète qui fera se « rencontrer » Jeanne Bécu au Roi Louis XV. Jeanne Bécu épousera son frère pour limiter le scandale. En 1777, Jean-Baptiste fait bâtir cet hôtel luxueux aux peintures toutes faites de luxure. Associé à l’Ancien Régime, il est guillotiné en 1794. Des bénédictines prennent possession de l’hôtel en 1817. Il faut attendre 1884 pour que l’hôtel deviennent un lycée et 1933 pour qu’une restauration intervienne. Son faste est en grande partie perdue mais le bâtiment est encore là pour nous rappeler une autre page de l’histoire de Toulouse.
XIXème siècle : Maison Lamothe

Au XIXème siècle, Toulouse évolue et se modernise. Au cœur du centre de la ville, le couvent des Trinitaires et détruit et laisse place à un îlot de modernité. Urbain Vitry, l’architecte de Toulouse va planifier et faire bâtir la Maison Lamothe. La couleur de la brique s’y retrouve pour s’harmoniser avec le reste du centre-ville. L’ensemble figure dans un style d’inspiration italienne. Des niches sont installées aux deuxièmes et troisièmes étages accueillants des statues et bustes en terre cuites.
XXème siècle : le siège art-déco de La Dépêche

Journal de premier plan en Occitanie, La Dépêche paraît pour la première fois le 2 octobre 1870. Jean Jaurès y écrira ses premiers articles. Georges Clemenceau passera également par La Dépêche pour quelques articles. Le journal prend de l’ampleur et il sera décidé de construire un nouveau siège en 1924. Un projet moderne est mis sur pied en 1926 par l’architecte Léon Jaussely. Il émerge donc en 1932 un bâtiment art-déco dans la rue d’Alsace-Lorraine de Toulouse. La façade est recouverte de mosaïques impliquant une femme dans une position forte et élégamment drapée. Le bleu domine mais d’autres couleurs font leur entrée. Les rayons partant de la tête féminine évoquent les domaines que couvre le journal (comme les arts, la littérature, l’industrie, …).
L’architecture est toujours le reflet de la société, de son savoir-faire, de ses besoins, de ses habitudes. Elle est aussi révélatrice de la richesse et du statut de celui qui fait bâtir. Toujours est-il que Toulouse est un musée à ciel ouvert avec ses façades. Tant d’autres attendent d’être vues … Terminons ce petit voyage avec l’Immeuble Benjamin de 1939, de style art déco aux allure « paquebot ». L’Histoire est partout il suffit parfois de lever ou de baisser les yeux pour en apercevoir le passage.